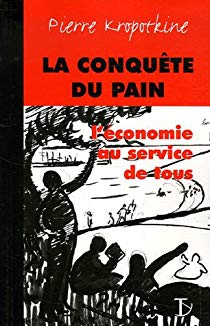
L’humanité a fait un bout de chemin depuis ces âges reculésdurant lesquels l’homme, façonnant en silex des outils rudimentaires, vivait des hasards de la chasse et ne laissait pour tout héritage à ses enfants qu’un abri sous les rochers, que de pauvres ustensiles en pierre, - et la Nature, immense, incomprise, terrible, avec laquelle ils devaient entrer en lutte pour maintenir leur chétive existence.
Pendant cette période troublée qui a duré des millierset des milliers d’années, le genre humain a cependant accumulé des trésors inouïs. Il a défriché le sol, desséché les marais, percé les forêts, tracé des routes ; bâti, inventé, observé, raisonné ; créé un outillage compliqué, arraché ses secrets à la Nature, dompté la vapeur ; si bien qu’à sa naissance l’enfant de l’homme civilisé trouve aujourd’hui à son service tout un capital immense, accumulé par ceux qui l’ont précédé. Et ce capital lui permet maintenant d’obtenir, rien que par son travail, combiné avec celui des autres, des richesses dépassant les rêves des Orientaux dans leurs contes des Mille et une Nuits.
Le sol est, en partie, défriché, prêt à recevoir le labour intelligent et les semences choisies, à se parer de luxuriantes récoltes - plus qu’il n’en faut pour satisfaire tous les besoins de l’humanité. Les moyens de culture sont connus.
Sur le sol vierge des prairies de l’Amérique, cent hommes aidés de machines puissantes produisent en quelques mois le blé nécessaire pour la vie de dix mille personnes pendant toute une année. Là où l’homme veut doubler, tripler, centupler son rapport il fait le sol, donne à chaque plante les soins qui lui conviennent et obtient des récoltes prodigieuses. Et tandis que le chasseur devait s’emparer autrefois de cent kilomètres carrés pour y trouver la nourriture de sa famille, le civilisé fait croître, avec infiniment moins de peine et plus de sûreté, tout ce qu’il lui faut pour faire vivre les siens sur une dix millième partie de cet espace.
Le climat n’est plus un obstacle. Quand le soleil manque, l’homme le remplace par la chaleur artificielle, en attendant qu’il fasse aussi la lumière pour activer la végétation. Avec du verre et des conduits d’eau chaude, il récolte sur un espace donné dix fois plus de produits qu’il n’en obtenait auparavant.
Les prodiges accomplis dans l’industrie sont encore plus frappants. Avec ces êtres intelligents, les machines modernes, - fruit de trois ou quatre générations d’inventeurs, la plupart inconnus, - cent hommes fabriquent de quoi vêtir dix mille hommes pendant deux ans. Dans les mines de charbon bien organisées, cent hommes extraient chaque année de quoi chauffé dix mille familles sous un ciel rigoureux. Et l’on a vu dernièrement toute une cité merveilleuse surgir en quelques mois au Champ de Mars, sans qu’il y ait eu la moindre interruption dans les travaux réguliers de la nation française.
Et si, dans l’industrie comme dans l’agriculture, comme dans l’ensemble de notre organisation sociale, le labeur de nos ancêtres ne profite surtout qu’au très petit nombre, - il n’en est pas moins certain que l’humanité pourrait déjà se donner une existence de richesse et de luxe, rien qu’avec les serviteurs de fer et d’acier qu’elle possède.
Oui certes, nous sommes riches, infiniment plus que nous ne le pensons. Riches par ce que nous possédons déjà ; encore plus riches par ce que nous pouvons produire avec l’outillage actuel. Infiniment plus riches par ce que nous pourrions obtenir de notre sol, de nos manufactures, de notre science et de notre savoir technique, s’ils étaient appliqués à procurer le bien-être de tous. II
Nous sommes riches dans les sociétés civilisées. Pourquoi donc autour de nous cette misère ? Pourquoi ce travail pénible, abrutissant des masses ? Pourquoi cette insécurité du lendemain, même pour le travailleur le mieux rétribué, au milieu des richesses héritées du passé et malgré les moyens puissants de production qui donneraient l’aisance à tous, en retour de quelques heures de travail journalier ?
Les socialistes l’ont dit et redit à satiété. Chaque jour ils le répètent, le démontrent par des arguments empruntés à toutes les sciences. Parce que tout ce qui est nécessaire à la production le sol, les mines, les machines, les voies de communication, la nourriture ; l’abri, l’éducation, le savoir - tout a été accaparé par quelques-uns dans le cours de cette longue histoire de pillage, d’exodes, de guerres, d’ignorance et d’oppression, que l’humanité a vécue avant d’avoir appris à dompter les forces de la Nature.
Parce que, se prévalant de prétendus droits acquis dans le passé, ils s’approprient aujourd’hui les deux tiers des produits du labeur humain qu’ils livrent au gaspillage le plus insensé, le plus scandaleux ; parce que, ayant réduit les masses à n’avoir point devant elles de quoi vivre un mois ou même huit jours, ils ne permettent à l’homme de travailler que s’il consent à leur laisser prélever la part du lion ; parce qu’ils l’empêchent de produire ce dont il a besoin et le forcent à produire, non pas ce qui serait nécessaire aux autres, mais ce qui promet les plus grands bénéfices à l’accapareur.
Tout le socialisme est là !
Voici, en effet, un pays civilisé. Les forêts qui le couvraient autrefois ont été éclaircies, les marais asséchés, le climat assaini : il a été rendu habitable.
Le sol qui ne portait jadis que des herbes grossières, fournit aujourd’hui de riches moissons. Les rochers qui surplombent les vallées du midi sont taillés en terrasses où grimpent les vignes au fruit doré. Des plantes sauvages qui ne donnaient jadis qu’un fruit âpre, - une racine immangeable, - ont ététransformées par des cultures successives en légumes succulents, en arbres chargés de fruits exquis. Des milliers de routes pavées et ferrées sillonnent la terre, percent les montagnes ; la locomotive siffle dans les gorges sauvages des Alpes, du Caucase, de l’Himalaya. Les rivières ont été rendues navigables ; les côtes, sondées et soigneusement relevées, sont d’accès facile ; des ports artificiels, péniblement creusés et protégés contre les fureurs de l’Océan, donnent refuge aux navires. Les roches sont percées de puits profonds ; des labyrinthes de galeries souterraines s’étendent là où il y a du charbon à extraire, du minerai à recueillir. Sur tous les points où des routes s’entrecroisent, des cités ont surgi, elles ont grandi, et dans leurs enceintes se trouvent tous les trésors de l’industrie, de l’art, de la science.
Des générations entières, nées et mortes dans la misère, opprimées et maltraitées par leurs maîtres, exténuées de labeur, ont légué cet immense héritage au XIXe siècle.
Pendant des milliers d’années, des millions d’hommes ont travaillé à éclaircir les futaies, à assécher les marais, à frayer les routes, à endiguer les rivières. Chaque hectare du sol que nous labourons en Europe a été arrosé des sueurs de plusieurs races ; chaque route a toute une histoire de corvées, de travail surhumain, de souffrances du peuple. Chaque lieue de chemin de fer, chaque mètre de tunnel ont reçu leur part de sang humain.
Les puits des mines portent encore, toutes fraîches, les entailles faites dans le roc par le bras du piocheur. D’un poteau à l’autre les galeries souterraines pourraient être marquées d’un tombeau de mineur, enlevé dans la force de l’âge par le grisou, l’éboulement ou l’inondation, et l’on sait ce que chacun de ces tombeaux a coûté de pleurs, de privations, de misères sans nom, à la famille qui vivait du maigre salaire de l’homme enterré sous les décombres.
Les cités, reliées entre elles par des ceintures de fer et des lignes de navigation, sont des organismes qui ont vécu des siècles. Creusez-en le sol, et vous y trouverez les assises superposées de rues, de maisons, de théâtres, d’arènes, de bâtiments publics. Approfondissez-en l’histoire, et vous verrez comment la civilisation de la ville, son industrie, son génie, ont lentement grandi et mûri par le concours de tous ses habitants, avant d’être devenus ce qu’ils sont aujourd’hui
Et maintenant encore, la valeur de chaque maison, de chaque usine, de chaque fabrique, de chaque magasin, n’est faite que du labeur accumulé des millions de travailleurs ensevelis sous terre ; elle ne se maintient que par l’effort des légions d’hommes qui habitent ce point du globe. Chacun des atomes de ce que nous appelons la richesse des nations, n’acquiert sa valeur que par le fait d’être une partie de cet immense tout. Que seraient un dock de Londres ou un grand magasin de Paris s’ils ne se trouvaient situés dans ces grands centres du commerce international ? Que seraient nos mines, nos fabriques, nos chantiers et nos voies ferrées, sans les amas de marchandises transportées chaque jour par mer et par terre ?
Des millions d’êtres humains ont travaillé à créer cette civilisation dont nous nous glorifions aujourd’hui. D’autres millions, disséminés dans tous les coins du globe, travaillent à la maintenir. Sans eux, il n’en resterait que décombres dans cinquante ans.
Il n’y a pas jusqu’à la pensée, jusqu’à l’invention, qui ne soient des faits collectifs, nés du passé et du présent. Des milliers d’inventeurs, connus ou inconnus, morts dans la misère, ont préparé l’invention de chacune de ces machines dans lesquelles l’homme admire son génie. Des milliers d’écrivains, de poètes, de savants, ont travaillé à élaborer le savoir, à dissiper l’erreur, à créer cette atmosphère de pensée scientifique, sans laquelle aucune des merveilles de notre siècle n’eût pu faire son apparition. Mais ces milliers de philosophes, de poètes, de savants et d’inventeurs n’avaient-ils pas été suscités eux aussi par le labeur des siècles passés ? N’ont-ils pas été, leur vie durant, nourris et supportés, au physique comme au moral, par des légions de travailleurs et d’artisans de toute sorte ? N’ont-ils pas puisé leur force d’impulsion dans ce qui les entourait ?
Le génie d’un Séguin, d’un Mayer et d’un Grove ont certainement fait plus pour lancer l’industrie en des voies nouvelles que tous les capitalistes du monde. Mais ces génies eux-mêmes sont les enfants de l’industrie aussi bien que de la science. Car il a fallu que des milliers de machines à vapeur transformassent d’année en année, sous les yeux de tous, la chaleur en force dynamique, et cette force en son, en lumière et en électricité, avant que ces intelligences géniales vinssent proclamer l’origine mécanique et l’unité des forces physiques. Et si nous, enfants du XIXe siècle, avons enfin compris cette idée, si nous avons su l’appliquer, c’est encore parce que nous y étions préparés par l’expérience de tous les jours. Les penseurs du siècle passé l’avaient aussi entrevue et énoncée : mais elle resta incomprise, parce que le XVIIIe siècle n’avait pas grandi, comme nous, à côté de la machine à vapeur.
Que l’on songe seulement aux décades qui se seraient écoulées encore dans l’ignorance de cette loi qui nous a permis de révolutionner l’industrie moderne, si Watt n’avait pas trouvé à Soho des travailleurs habiles pour construire, en métal, ses devis théoriques, en perfectionner toutes les parties et rendre enfin la vapeur, emprisonnée dans un mécanisme complet, plus docile que le cheval, plus maniable que l’eau ; la faire en un mot l’âme de l’industrie moderne.
Chaque machine a la même histoire : longue histoire de nuits blanches et de misère, de désillusions et de joies, d’améliorations partielles trouvées par plusieurs générations d’ouvriers inconnus qui venaient ajouter à l’invention primitive ces petits riens sans lesquels l’idée la plus féconde reste stérile. Plus que cela, chaque invention nouvelle est une synthèse - résultat de mille inventions précédentes dans le champ immense de la mécanique et de l’industrie.
Science et industrie, savoir et application, découverte et réalisation pratique menant à de nouvelles découvertes, travail cérébral et travail manuel, - pensée et oeuvre des bras - tout se tient. Chaque découverte, chaque progrès, chaque augmentation de la richesse de l’humanité a son origine dans l’ensemble du travail manuel et cérébral du passé et du présent.
Alors, de quel droit quiconque pourrait-il s’approprier la moindre parcelle de cet immense tout, et dire : ceci est à moi, non à vous ?
III
Mais il arriva, pendant la série des âges traversés par l’humanité, que tout ce qui permet à l’homme de produire et d’accroître sa force de production fût accaparé par quelques-uns. Un jour nous raconterons peut-être comment cela s’est passé. Pour le moment il nous suffit de constater le fait et d’en analyser les conséquences.
Aujourd’hui, le sol qui tire sa valeur précisément des besoins d’une population toujours croissante, appartient aux minorités qui peuvent empêcher, et empêchent, le peuple de le cultiver, ou ne lui permettent pas de le cultiver selon les besoins modernes. Les mines qui représentent le labeur de plusieurs générations, et qui ne dérivent leur valeur que des besoins de l’industrie et de la densité de la population, appartiennent encore à quelques-uns ; et ces quelques-uns limitent l’extraction du charbon ou la prohibent totalement, s’ils trouvent un placement plus avantageux pour leurs capitaux. La machine aussi est encore la propriété de quelques-uns seulement, et lors même que telle machine représente incontestablement les perfectionnements apportés à l’engin primitif par trois générations de travailleurs, elle n’en appartient pas moins à quelques patrons ; et si les petits-fils de ce même inventeur qui construisit, il y a cent ans, la première machine à dentelles se présentaient aujourd’hui dans une manufacture de Bâle ou de Nottingham et réclamaient leur droit, on leur crierait : " Allez-vous-en ! Cette machine n’est pas à vous ! " et on les fusillerait s’ils voulaient en prendre possession.
Les chemins de fer, qui ne seraient que ferraille inutile sans la population si dense de l’Europe, sans son industrie, son commerce et ses échanges, appartiennent à quelques actionnaires, ignorant peut-être où se trouvent les routes qui leur donnent des revenus supérieurs à ceux d’un roi du Moyen Age. Et si les enfants de ceux qui mouraient par milliers en creusant les tranchées et les tunnels se rassemblaient un jour et venaient, foule en guenilles et affamée, réclamer du pain aux actionnaires, ils rencontreraient les baïonnettes et la mitraille pour les disperser et sauvegarder les " droits acquis ".
En vertu de cette organisation monstrueuse, le fils du travailleur, lorsqu’il entre dans la vie, ne trouve ni un champ qu’il puisse cultiver, ni une machine qu’il puisse conduire, ni une mine qu’il ose creuser sans céder une bonne part de ce qu’il produira à un maître. Il doit vendre sa force de travail pour une pitance maigre et incertaine. Son père et son grand-père ont travaillé à drainer ce champ, à bâtir cette usine, à perfectionner les machines ; ils ont travaillé dans la pleine mesure de leurs forces - et qui donc peut donner plus que cela ? - Mais il est, lui, venu au monde plus pauvre que le dernier des sauvages. S’il obtient la permission de s’appliquer à la culture d’un champ, c’est à condition de céder le quart du produit à son maître et un autre quart au gouvernement et aux intermédiaires. Et cet impôt, prélevé sur lui par l’Etat, le capitaliste, le seigneur et l’entremetteur, grandira toujours et rarement lui laissera même la faculté d’améliorer ses cultures. S’il s’adonne à l’industrie, on lui permettra de travailler, - pas toujours d’ailleurs - mais à condition de ne recevoir qu’un tiers ou la moitié du produit, le restant devant aller à celui que la loi reconnaît comme le propriétaire de la machine.
Nous crions contre le baron féodal qui ne permettait pas au cultivateur de toucher à là terre, à moins de lui abandonner le quart de sa moisson. Nous appelons cela l’époque barbare. Mais, si les formes ont changé, les relations sont restées les mêmes. Et le travailleur accepte, sous le nom de contrat libre, des obligations féodales ; car nulle part il ne trouverait de meilleures conditions. Le tout étant devenu la propriété d’un maître, il doit céder ou mourir de faim !
Il résulte de cet état des choses que toute notre production se dirige à contre-sens. L’entreprise ne s’émeut guère des besoins de la société : son unique but est d’augmenter les bénéfices de l’entrepreneur. De là, les fluctuations continuelles de l’industrie, les crises à l’état chronique, - chacune d’elles jetant sur le pavé des travailleurs par centaines de mille.
Les ouvriers ne pouvant acheter avec leurs salaires les richesses qu’ils ont produites, l’industrie cherche des marchés au dehors, parmi les accapareurs des autres nations. En Orient, en Afrique, n’importe où, Egypte, Tonkin, Congo, l’européen, dans ces conditions, doit accroître le nombre de ses serfs. Mais partout il trouve des concurrents, toutes les nations évoluant dans le même sens. Et les guerres, - la guerre en permanence, - doivent éclater pour le droit de primer sur les marchés. Guerres pour les possessions en Orient ; guerres pour l’empire des mers ; guerres pour imposer des taxes d’entrée et dicter des conditions à ses voisins ; guerres contre ceux qui se révoltent ! Le bruit du canon ne cesse pas en Europe, des générations entières sont massacrées, les Etats européens dépensent en armements le tiers de leurs budgets, - et l’on sait ce que sont les impôts et ce qu’ils coûtent au pauvre.
L’éducation reste le privilège des minorités infimes. Car, peut-on parler d’éducation quand l’enfant de l’ouvrier est forcé à treize ans de descendre dans la mine, ou d’aider son père à la ferme ! Peut-on parler d’études à l’ouvrier qui rentre le soir, brisé par une journée d’un travail forcé, presque toujours abrutissant ! Les sociétés se divisent en deux camps hostiles, et dans ces conditions la liberté devient un vain mot. Tandis que le radical demande une plus grande extension des libertés politiques, il s’aperçoit bientôt que le souffle de liberté mène rapidement au soulèvement des prolétaires ; et alors il tourne, change d’opinion et revient aux lois exceptionnelles et au gouvernement du sabre.
Un vaste ensemble de tribunaux, de juges et de bourreaux, de gendarmes et de geôliers, est nécessaire pour maintenir les privilèges, et cet ensemble devient lui-même l’origine de tout un système de délations, de tromperies, de menaces et de corruption.
En outre, ce système arrête le développement des sentiments sociables. Chacun comprend que sans droiture, sans respect de soi-même, sans sympathie et sans support mutuels, l’espèce doit dépérir, comme dépérissent les quelques espèces animales vivant de brigandage et de servage. Mais cela ne ferait pas le compte des classes dirigeantes, et elles inventent toute une science, absolument fausse pour prouver le contraire.
On a dit de belles choses sur la nécessité de partager ce que l’on possède avec ceux qui n’ont rien. Mais quiconque s’avise de mettre ce principe en pratique est aussitôt averti que tous ces grands sentiments sont bons dans les livres de poésie - non dans la vie. " Mentir, c’est s’avilir, se rabaisser ", disons-nous, et toute l’existence civilisée devient un immense mensonge. Et nous noushabituons, nous accoutumons nos enfants, à vivre avec une moralité à deux faces, en hypocrites ! Et le cerveau ne s’y prêtant pas de bonne grâce, nous le façonnons au sophisme. Hypocrisie et sophisme deviennent la seconde nature de l’homme civilisé.
Mais une société ne peut pas vivre ainsi ; il lui faut revenir à la vérité, ou disparaître.
Ainsi le simple fait de l’accaparement étend ses conséquences sur l’ensemble de la vie sociale. Sous peine de périr, les sociétés humaines sont forcées de revenir aux principes fondamentaux : les moyens de production étant l’œuvre collective de l’humanité, ils font retour à la collectivité humaine. L’appropriation personnelle n’en est ni juste, ni utile. Tout est à tous, puisque tous en ont besoin, puisque tous ont travaillé dans la mesure de leurs forces et qu’il est matériellement impossible de déterminer la part qui pourrait appartenir à chacun dans la production actuelle des richesses.
Tout est à tous ! Voici un immense outillage que le XIXe siècle a créé ; voici des millions d’esclaves en fer que nous appelons machines et qui rabotent et scient, tissent et filent pour nous, qui décomposent et recomposent la matière première, et font les merveilles de notre époque. Personne n’a le droit de s’emparer d’une seule de ces machines et de dire " elle est à moi ; pour en user vous me paierez un tribut sur chacun de vos produits " ; - pas plus que le seigneur du Moyen Age n’avait le droit de dire au cultivateur : " Cette colline, ce pré sont à moi et vous me paierez un tribut sur chaque gerbe de blé que vous récolterez, sur chaque meule de foin que vous entasserez. "
Tout est à tous ! Et pourvu que l’homme et la femme apportent leur quote-part de travail, ils ont droit à leur quote-part de tout ce qui sera produit par tout le monde. Et cette part leur donnera déjà l’aisance.
Assez de ces formules ambiguës telles que le " droit au travail ", ou " à chacun le produit intégral de son travail ". Ce que nous proclamons, c’est LE DROIT A L’AISANCE - L’AISANCE POUR TOUS.
